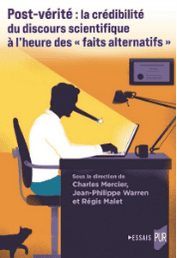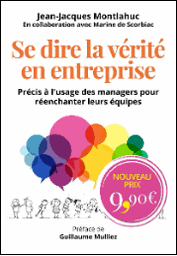Newsletter 66 – Entre vérité dure et justesse utile : la ligne de crête des managers
La vérité a-t-elle encore droit de cité ? On peut s’en inquiéter depuis que la révolution numérique a transformé chacun de ses bénéficiaires en émetteur d’informations largement diffusées mais aucunement vérifiées.
Les réputations se font et se défont cruellement sur les réseaux sociaux. Certaines fake news séduisent tant de crédules qu’elles parviennent à les agréger en virtuelle nation de complotistes qui s’activent pour nuire.
La vogue américaine des « faits alternatifs » s’emploie à défaire des vérités scientifiques que l’Occident a laborieusement mises au jour depuis le XVIIe siècle pour tant de progrès émancipateurs.
L’IA crée désormais des propos et des images capables de nous faire croire n’importe quoi. Souhaitons qu’un ordre mondial soucieux de démocratie parvienne au plus vite à la régulation qui s’impose : réhabiliter le rôle indispensable des experts pour qu’ils apposent ou non sur chaque contenu un label authentificateur.
Car, comme disent les Anglosaxons, les faits sont têtus et, même s’il faut forcément les mettre dans la perspective d’une interprétation, nul ne devrait avoir le droit de les déformer à sa guise.
Pour autant, la vérité suffit-elle à mobiliser les humains ? Tout manager sait parfaitement que non. Reste à définir les bornes à l’intérieur desquelles le collectif reste capable de regarder la réalité en face sans se priver pour autant de poursuivre des objectifs motivants.
Dire la vérité en entreprise mais avec justesse
À ceux qui prétendent aujourd’hui que « la vérité, ce n’est plus le sujet », rétorquons qu’elle reste cruciale mais qu’effectivement, « elle n’est pas le seul sujet, elle n’est pas tout le sujet ».
Car à défaut de « dire juste », ça ne passe pas.
Un plan social annoncé sans ménagement peut être pertinent au regard d’un bilan véritable et pourtant déstabiliser durablement le collectif ; à l’inverse, une vision stratégique racontée avec souffle peut mobiliser.
Dire juste en entreprise, c’est dire vrai au bon niveau, au bon moment et pour le bon effet. Tout n’a pas à être dit tout de suite, rien ne doit être dit trop tard.
Les dirigeants avancent donc sur une crête étroite, puisqu’ils doivent résister à deux tentations funestes : celle de « tout balancer » au risque de brutaliser, et celle de se contenter d’une « approximation qui rassure », au risque d’édulcorer.
Loin du storytelling manipulateur, la vérité en entreprise exige une mise en récit responsable sur ce qui est dit et comment on le dit.
Au quotidien, pourquoi tout dire si cela ne change rien à l’action ?
À l’inverse, le manager peut-il taire ce qui blesse si cela évite un dommage immédiat ?
Trois filtres, simples mais exigeants, l’aideront à trancher.
- L’utilité d’abord : ce que je dis permet-il aux équipes d’agir mieux demain matin, en termes de priorités, de ressources, de délais ?
- La non-nuisance ensuite : mon message minimise-t-il les effets collatéraux inutiles (rumeurs, peurs, stigmatisation) ?
- La mobilisation enfin : cette vérité suscite-t-elle l’envie d’y aller, en avançant ne serait-ce que d’un pas, fût-il imparfait ?
Ce triptyque n’autorise ni le mensonge, ni l’édulcoration ; il impose une ingénierie du langage, sorte de thermostat motivant qui régule et engage, par opposition au thermomètre qui ne fait que constater en décourageant.